141 - Sommes-nous tous racistes?
Mardi 27 novembre 2007
Je vous propose aujourd'hui de réfléchir sur le texte ci-dessous, extrait du livre "Ce que je crois, Dominant et Dominé" d'Albert Memmi (1985)
Memmi distingue ici le racisme de l'hétérophobie, terme qu'il invente pour désigner la peur de l'altérité. Pour lui, le racisme n'est qu'une forme sociétale d'un concept plus général, cette fameuse hétérophobie (que j'aurais plus volontier nommée altérophobie)
Ainsi, à la question "somme-nous tous racistes?", il répond "non, mais nous sommes tous hétérophobes". La réflexion mérite d'être partagée... Il nous faut admettre, en même temps, ces deux constats: le racisme est insoutenable, par n’importe quel esprit, même médiocrement doué, et il y a en nous quelque chose qui, presque malgré nous, nous pousse sous une forme ou sous une autre, à le soutenir. C’est contradictoire, embarrassant et assez terrible. Ce moteur inlassable, inusable, jusqu’ici en tout cas, j’ai proposé de l’appeler, d’un terme qu’il m’a fallu forger: l’hétérophobie ou la peur d’autrui. Ce malaise diffus devant les autres, il est aussi difficile d’en rendre compte que de l’amour d’autrui, avec lequel, heureusement, il coexiste. C’est un fait aussi dense, aussi inesquivable, complémentaire, comme s'il n’y avait guère de zone neutre.
Il nous faut admettre, en même temps, ces deux constats: le racisme est insoutenable, par n’importe quel esprit, même médiocrement doué, et il y a en nous quelque chose qui, presque malgré nous, nous pousse sous une forme ou sous une autre, à le soutenir. C’est contradictoire, embarrassant et assez terrible. Ce moteur inlassable, inusable, jusqu’ici en tout cas, j’ai proposé de l’appeler, d’un terme qu’il m’a fallu forger: l’hétérophobie ou la peur d’autrui. Ce malaise diffus devant les autres, il est aussi difficile d’en rendre compte que de l’amour d’autrui, avec lequel, heureusement, il coexiste. C’est un fait aussi dense, aussi inesquivable, complémentaire, comme s'il n’y avait guère de zone neutre.
Une jeune femme essaye de me l’expliquer:«Tout homme me semble toujours prêt à porter atteinte à ma liberté, à mon intégrité … sauf l’homme que j’aime, mais alors il ne me semble plus exactement un homme.» En somme, il cesse d’être un inconnu différent et dangereux.
Pourtant cette force, cette inclination à accuser autrui, à l’agresser, sous divers prétextes, nous la connaissons bien: nous en avons une très fréquente expérience, même si son contenu est confus, plus émotionnel que raisonnable. En gros, chaque fois que nous nous trouvons devant un individu ou un groupe différent ou mal connu, nous en ressentons quelque malaise. Dans une entreprise comme dans une armée; même au sein d’un clergé; ne parlons pas des artistes menés par leur excessive sensibilité. Notre inquiétude peut nous pousser à adopter des attitudes de méfiance et même de refus hostile. Lesquelles n’excluent pas, du reste, des sentiments ambivalents, d’attente et d’espoir: on le voit chez l’enfant, toujours prêt, à la fois, à prendre peur et à sourire (question classique; l’enfant est-il raciste? Evidemment non, il n’en possède pas l’argumentation, mais il est candidat à l’hétérophobie. ) On le voit dans le tourisme, où l’inconnu nous fascine et nous inquiète. C’est pourquoi certains philosophes ont pu affirmer que l’homme est un loup pour l’homme, et d’autres que l’homme est plein d’amour pour l’homme: chaque partie a exprimé la moitié de la vérité.
Plus grave: cette réaction, à base de peur et de concurrence, ne relève pas seulement du délire: elle a une fonction: elle fut et, en un sens, reste vitale pour l’espèce humaine. Pour survivre, l’homme a dû souvent défendre son intégrité et ses biens, et, à l’occasion, s’approprier ceux d’autrui, biens mobiliers et immobiliers, aliments, matières premières, territoires, femmes, biens réels ou imaginaires, religieux, culturels et symboliques. De sorte qu’il est à la fois agresseur et agressé, terrifiant et terrifié. Car, puisque chacun en fait autant, on ne sait plus où commence ce cercle infernal de la défense et de l’agression. Cela fait partie de notre histoire et de notre mémoire collective; et avons-nous vraiment changé depuis?
[…]
Ce refus terrifié et agressif d’autrui n’est pas encore exactement le racisme. Mais le racisme est une élaboration discursive, une justification de ces émotions simples. Il m’a semblé nécessaire de distinguer ces deux niveaux et de les nommer différemment. Sinon, personne n’avouerait son hétérophobie, avec laquelle nous devons pourtant composer pour mieux exorciser le racisme. Inutile de soupçonner et d’accuser tout le monde: sommes-nous tous racistes? Non, mais nous sommes tous exposés à l’hétérophobie. Le racisme vient se greffer sur ce fond commun et se singularise selon la tradition culturelle de chacun, et la victime occasionnelle qu’il rencontre. C’est la société, notre langage, notre littérature, qui nous proposent complaisamment des moules, des casiers déjà préparés où ranger nos émotions. Inquiets, malgré nous, devant un homme aux traits asiatiques, nous puisons spontanément dans les figures négatives de Chinois ou de Japonais que nous offrent la littérature ou le cinéma. Idem pour les Juifs ou les Arabes, ou même pour les femmes. Sommes-nous déroutés devant une femme? Les stéréotypes de la garce, de la vamp, ou même de la sorcière, sont aussitôt à notre disposition. Cet aspect conjoncturel, culturel, du racisme ne le rend pas moins dangereux, car nous le suçons, tous ou presque, dès notre première gorgée de lait, nous l’avalons avec nos premières tartines, à l’école et dans la rue, dans les préjugés familiaux, dans les livres, les films, et même dans les religions. Mais si le racisme est social et culturel, l’hétérophobie est une donnée animale. Le racisme une misérable machine de mots pour justifier notre hétérophobie et en tirer profit. Discours aberrant et intéressé de l’hétérophobie, le racisme n’est qu’une illustration particulière d’un mécanisme plus vaste qui l’englobe.
Revenir à la page principale --- Sommaire de tous les billets

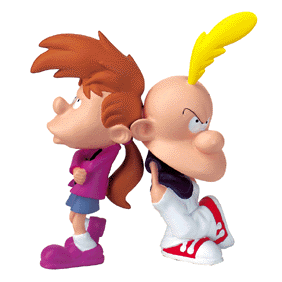


 Gérard Noiriel, historien spécialiste de l'immigration, est l'un des démissionnaires de la cité de l'histoire de l'immigration. Directeur d'études à l'EHESS, il préside le comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire. Auteur du « creuset français » (1988, 2006), il vient de publier « Racisme: la responsabilité des élites » (Textuel) et « A quoi sert l'identité nationale » (Agone).
Gérard Noiriel, historien spécialiste de l'immigration, est l'un des démissionnaires de la cité de l'histoire de l'immigration. Directeur d'études à l'EHESS, il préside le comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire. Auteur du « creuset français » (1988, 2006), il vient de publier « Racisme: la responsabilité des élites » (Textuel) et « A quoi sert l'identité nationale » (Agone). Nous avons un train de retard. La stratégie des responsables de l'UMP intègre désormais nos protestations. C'est un gros problème qui se pose à nous, très douloureux. On voit bien que l'opinion était plus favorable à ces tests à l'issue de la campagne sur les test ADN qu'au début. Les stratégies de pouvoir sont efficaces, en ce sens qu'elles imposent des problèmes d'actualité. Contester, c'est accepter le problème. J'ai fait une analyse de la campagne électorale de 2007, on voit parfaitement comment ce thème de l'identité nationale qui n'avait rien de neuf, a été repris, sans argument nouveau, par l'ensemble des grands partis politiques et par les médias comme quelque chose de fondamental. C'est de cette manière-là que Nicolas Sarkozy a récupéré les voix dont il avait besoin du côté du Front national pour gagner les élections. Aujourd'hui, le ministère de l'immigration et de l'identité nationale étant en place, il faut l'alimenter. On voit une stratégie qui vise à utiliser des mots qui font tilt dans l'opinion. Ce n'est pas un hasard: ADN d'un côté, statistiques ethniques de l'autre. Et l'on est piégé, parce que d'un côté, on ne peut pas laisser passer çà, mais d'un autre côté, ces oppositions contribuent à en faire des thèmes considérés comme prioritaires pour la France.
Nous avons un train de retard. La stratégie des responsables de l'UMP intègre désormais nos protestations. C'est un gros problème qui se pose à nous, très douloureux. On voit bien que l'opinion était plus favorable à ces tests à l'issue de la campagne sur les test ADN qu'au début. Les stratégies de pouvoir sont efficaces, en ce sens qu'elles imposent des problèmes d'actualité. Contester, c'est accepter le problème. J'ai fait une analyse de la campagne électorale de 2007, on voit parfaitement comment ce thème de l'identité nationale qui n'avait rien de neuf, a été repris, sans argument nouveau, par l'ensemble des grands partis politiques et par les médias comme quelque chose de fondamental. C'est de cette manière-là que Nicolas Sarkozy a récupéré les voix dont il avait besoin du côté du Front national pour gagner les élections. Aujourd'hui, le ministère de l'immigration et de l'identité nationale étant en place, il faut l'alimenter. On voit une stratégie qui vise à utiliser des mots qui font tilt dans l'opinion. Ce n'est pas un hasard: ADN d'un côté, statistiques ethniques de l'autre. Et l'on est piégé, parce que d'un côté, on ne peut pas laisser passer çà, mais d'un autre côté, ces oppositions contribuent à en faire des thèmes considérés comme prioritaires pour la France. Si vous replacez les choses dans leur contexte historique, vous voyez qu'à partir de l'affaire Dreyfus, vous avez eu deux blocs, en simplifiant: le bloc que j'appelle national sécuritaire et le bloc social humanitaire. Ces deux blocs se sont constitués en rapport avec le mouvement ouvrier qui a été l'événement majeur du vingtième siècle mais qui s'est effondré dans les années quatre-vingt. La gauche n'est plus parvenue à intervenir comme avant sur les droits de l'homme ou la question sociale. L'articulation entre l'humanitaire et le social a eu tendance à se défaire. C'est à ce moment que les ouvriers immigrés grévistes de l'automobile ont été lâchés en rase campagne par la gauche au début des années quatre vingt. Le discours de SOS racisme qui s'est substitué au précédent avait sa validité mais rejettait à la marge la dimension sociale. Le monde ouvrier s'est trouvé dans l'incapacité de rassembler ses différentes composantes. Quand on voit que les deux tiers des ouvriers on voté à droite aux dernières élections, on voit qu'il y a là un enjeu majeur. La question qui est posée c'est comment tenir un discours de gauche qui rassemble une majorité et qui tienne compte du fractionnement des identités.
Si vous replacez les choses dans leur contexte historique, vous voyez qu'à partir de l'affaire Dreyfus, vous avez eu deux blocs, en simplifiant: le bloc que j'appelle national sécuritaire et le bloc social humanitaire. Ces deux blocs se sont constitués en rapport avec le mouvement ouvrier qui a été l'événement majeur du vingtième siècle mais qui s'est effondré dans les années quatre-vingt. La gauche n'est plus parvenue à intervenir comme avant sur les droits de l'homme ou la question sociale. L'articulation entre l'humanitaire et le social a eu tendance à se défaire. C'est à ce moment que les ouvriers immigrés grévistes de l'automobile ont été lâchés en rase campagne par la gauche au début des années quatre vingt. Le discours de SOS racisme qui s'est substitué au précédent avait sa validité mais rejettait à la marge la dimension sociale. Le monde ouvrier s'est trouvé dans l'incapacité de rassembler ses différentes composantes. Quand on voit que les deux tiers des ouvriers on voté à droite aux dernières élections, on voit qu'il y a là un enjeu majeur. La question qui est posée c'est comment tenir un discours de gauche qui rassemble une majorité et qui tienne compte du fractionnement des identités.
